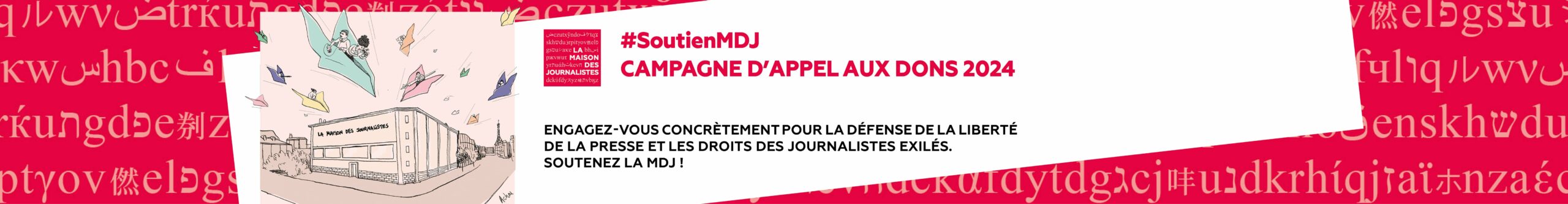Le massacre des Koulbars, encore un secret honteux de l’Iran
[Par Rebin RAHMANI]
Traduit du persan au français par Nujin
Silence, on tue. Les travailleurs frontaliers kurdes sont massacrés par le régime iranien dans l’indifférence générale et en toute impunité.
Ci-dessous un court-métrage documentaire consacrée à la question des koulbars kurdes produit par le Réseau pour les Droits de l’Homme au Kurdistan (sous-titré en anglais).
Les Kurdes sont un peuple apatride disloqué entre quatre États du Moyen-Orient (l’Iran, la Turquie, la Syrie et l’Irak) où ils constituent une minorité ethnique numériquement importante mais toujours politiquement oppressée, économiquement marginalisée et culturellement discriminée. Naitre kurde dans chacun de ces pays, c’est se retrouver privé du moindre droit en tant qu’individu appartenant à un peuple pourtant millénaire.
Dans la province du Kurdistan iranien située au Nord-Ouest de l’Iran près de la frontière irakienne et que les Kurdes appellent Kurdistan de l’Est ou Rojhelat, le régime de la République Islamique s’est toujours senti menacé par ce peuple insoumis et a mené dès 1979 une politique tout « sécuritaire » aussi bien dans le domaine politique, social, économique et culturel. La moindre aspiration autonomiste, nationaliste ou séparatiste a été systématiquement écrasée. On a vu des boutiques se voir imposer une fermeture administrative simplement à cause d’une enseigne en langue kurde et les propriétaires arrêtés au motif de « propagande nationaliste ». La République Islamique a toujours utilisé l’arme économique pour contrôler la région du Kurdistan notamment en faisant tout pour empêcher le développement économique et l’entreprenariat. Les résultats de cette politique volontaire de marginalisation économique ne se sont pas faits attendre : la région du Kurdistan compte parmi les plus pauvres d’Iran et le chômage y est galopant.
Trahir son peuple ou risquer les balles, le choix impossible des Kurdes d’Iran
Les Kurdes (qui représentent environ 10% de la population iranienne avec près de 7 millions d’habitants) paupérisés et désespérés n’ont quasiment que quatre options : devenir des agriculteurs, migrer vers des grandes villes d’Iran à la recherche d’un emploi, rejoindre les rangs des Gardiens de la Révolution Islamique et donc trahir leur peuple ou bien (c’est l’option la plus fréquemment choisie) devenir un transporteur frontalier de marchandises de contrebande (“koulbar” en langue kurde) entre l’Iran et l’Irak.
Chaque année, un nombre important de ces travailleurs pauvres sont pris pour cible par les forces armées de la République Islamique et abattus sans sommation dans l’exercice de leur activité alors qu’ils traversent la frontière entre l’Iran et l’Irak, leurs marchandises sur le dos. Un peu comme si en France, les Alsaciens qui s’essayaient au transport de marchandises entre la France et l’Allemagne dans l’espoir d’échapper à la misère étaient systématiquement abattus par la police française dans les zones frontalières.
Il y’a une dizaine de jours, le Réseau pour les Droits de l’Homme au Kurdistan (une association fondée en France en 2014 dans le but de documenter et d’informer sur les violations des droits de l’Homme dans la province du Kurdistan iranien) a publié son rapport annuel concernant le massacre systématique de ces travailleurs nomades kurdes et est en mesure de fournir quelques chiffres. En 2015, au moins 44 koulbars kurdes ont été tués par les forces armées du régime et au moins 21 autres ont été blessés. Au moins sept autres sont morts d’hypothermie, se sont noyés dans des rivières ou lors de chutes dans les montagnes. De très jeunes kurdes exercent également cette profession : en 2015 deux jeunes koulbars de moins de 17 ans dont l’un a été identifié comme étant Seyffedine Nouri ont été assassinés par les forces armées iraniennes. La moitié des victimes sont assassinés dans des villages frontaliers et l’autre moitié dans des villes ou villages parfois éloignés de plus de 100 km de la frontière.
Pourquoi, « Koulbar » ?
« Koulbar » est un mot valise kurde formé à partir du mot « koul » qui signifie « dos » et du mot « bar » qui signifie « transport ». Il désigne ces travailleurs nomades kurdes iraniens vivant dans cette zone frontalière de carrefour entre le Kurdistan iranien et irakien. Démunis et désespérés de ne pouvoir faire subsister leurs familles, ces hommes choisissent de transporter à dos d’homme (ou à dos de mulets) des marchandises de contrebande telles que du textile, des produits électroniques, des boîtes de thé et plus rarement (même si ça arrive quelquefois) des boissons alcoolisées qu’ils vont chercher côté irakien afin de les introduire en Iran. Ils chargent ces marchandises le plus souvent sur leurs dos et retraversent la frontière le plus discrètement possible, généralement la nuit, dans la neige, en prenant garde à ne pas exploser sur une mine anti-personnel vestige de la guerre Iran-Irak et à éviter les tirs nourris des militaires iraniens en embuscade dans la région.
Les boutiquiers (ou kassebkar) quant à eux sont ces marchands qui récupèrent ces marchandises auprès des koulbars et vont les revendre dans des villes ou villages sur l’ensemble du territoire iranien.
Bien entendu, la plupart des Kurdes qui se tournent vers cette périlleuse profession sont bien conscients des risques, mais cette vie laborieuse leur paraît préférable à une vie de servitude contre leur propre peuple au sein des Gardiens de la Révolution. Le chômage endémique, l’absence d’opportunités professionnelles, la faible part du budget national allouée au développement du Kurdistan, le non-investissement de l’État dans l’agriculture, les mines toujours enfouies et actives dans le sol du Kurdistan depuis la fin du conflit avec l’Irak en 1988 et bien d’autres problèmes désespèrent ces jeunes kurdes qui n’ont d’autres choix que de se tourner à leurs risques et périls vers cette dangereuse profession.
La question des koulbars kurdes pourrait n’être qu’un simple problème économique qui se pose dans quasiment toutes les régions du monde : celui de la contrebande de marchandises. Quel pays peut prétendre ne jamais y avoir été confronté ? Néanmoins, le Régime de la République Islamique, fidèle à ses habitudes, traite ce problème économique comme un problème sécuritaire et use de la répression et de la plus grande violence à l’égard de ceux qu’il accuse de contrebande.
En théorie, les lois de la République Islamique ont prévu une sanction spécifique pour chaque type de délit ou crime en fonction de sa gravité et en théorie chaque individu reconnu coupable doit être condamné en fonction de cette grille. Cependant, les faits prouvent que le régime ne respecte pas ces propres règles. Dans la majorité des cas, les koulbars sont considérés coupables de contrebande avant même d’être arrêtés ou jugés et sont abattus sur place et sans sommation préalable par les forces armées iraniennes qui patrouillent systématiquement dans la région.
Ces dernières années, le gouvernement central iranien a vainement tenté de lutter contre ce phénomène de contrebande qui loin de faiblir malgré le nombre effarant de victimes parmi les koulbars, ne faisait au contraire qu’augmenter. Pour cela, il a instauré un semblant de libre circulation des marchandises dans les zones de Mariwan et Bané (à la frontière irakienne) et a distribué des autorisations de travail pour un certain nombre de koulbars. Toutefois, cette tentative a plus tard fait l’objet d’une mesure d’impeachment par le Parlement Iranien et n’a pu obtenir de voix suffisantes pour être maintenue. Un certain nombre de koulbars qui travaillaient légalement ont du se tourner vers la contrebande illégale.
Un massacre aveugle
Il n’y a pas que les koulbars qui tombent sous les balles. Les bêtes de sommes qui accompagnent le labeur de ces infatigables travailleurs nomades ne sont pas épargnées. Chaque année une bonne centaine de ces malheureux animaux sont également massacrés. Un koulbar originaire de Bané a raconté au Réseau pour les droits de l’Homme au Kurdistan : « Les forces armées iraniennes et les Gardiens de la Révolution patrouillent dans les zones empruntées par les koulbars et nous tendent des embuscades. Quand ils nous arrêtent, ils confisquent nos marchandises puis regroupent nos bêtes et les mitraillent littéralement sous nos yeux. Plus d’une fois, j’ai même vu les forces du régime incendier nos bêtes. Quand ils nous arrivent de croiser leur route, nous avons si peur d’être arrêtés que nous déguerpissons en catastrophe en laissant tout derrière nous. Les forces du régime se vengent sur nos animaux et balancent les carcasses sur les routes.”
Les efforts de collecte d’informations effectuées sur le terrain par le Réseau pour les Droits de l’Homme au Kurdistan permettent d’attester que depuis 2011, au moins 439 travailleurs frontaliers ont été tués ou blessés dans l’exercice de leur activité par les forces armées iraniennes. Ces travailleurs nomades qui comptent parmi les plus pauvres et les laissés pour compte du Kurdistan, laissent après leur mort brutale des familles endeuillées qui perdent par la même occasion leur unique source de revenus. Non seulement, l’État ne leur verse aucune indemnité après la mort de leur proche mais leur demande de verser une somme d’argent en compensation du prix des balles qui a servi à abattre leur mari, frère ou fils afin que le corps leur soit rendu.
Certaines familles ont eu le courage de porter plainte contre l’État iranien mais aucune de ces plaintes n’a conduit à l’arrestation et encore moins à la condamnation des coupables (qui dans le meilleur des cas ont simplement été mutés dans d’autres régions). Des citoyens et activistes kurdes manifestent régulièrement pour protester contre ces massacres et sont systématiquement arrêtés par les forces de sécurité du régime.
Une seule fois et unique fois en 2011, Ahmad Shaheed le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des Droits de l’Homme en Iran a mentionné dans son rapport annuel (sous la forte pression d’activistes kurdes) les meurtres systématiques de ces koulbars. Aucune autre organisation internationale de défense des droits de l’homme n’a évoqué ce problème et le silence assourdissant autour de ces massacres continue en toute impunité.