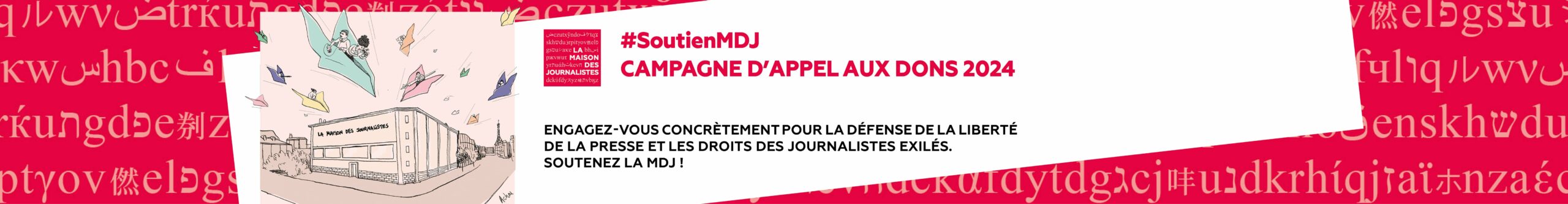R.D. CONGO. Des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées. S’achemine-t-on vers un génocide ?
En ébullition depuis 1997, année de départ du pouvoir de Mobutou Sese Seko, ancien président ayant dirigé le pays d’une main de fer pendant 32 ans, le Congo a, tour à tour, connu plusieurs guerres causées par des groupes rebelles qui sévissent dans l’est du territoire notamment dans la région du Kivu. D’après le journaliste et politologue Charles Onana qui parle d’holocauste, ces guerres ont causé déjà plus de 10 millions de morts et plus de 500 000 femmes violées.
Très déçu de la situation chaotique de leur pays vers la fin du règne de Mobutou, Laurent Désiré Kabila avait suscité beaucoup d’espoir chez les Congolais. Vieux routier de la rébellion et de l’agitation politique, il était arrivé à la tête de l’État porté par une coalition de groupes rebelles en provenance des pays voisins : Rwanda et Ouganda. Mais après quatre années de pouvoir secouées par d’intenses massacres dans l’est du pays, causés par ses propres groupes rebelles qui s’y étaient recroquevillés, il mourrait assassiné par un de ses aides de camp. Son fils, Joseph Kabila, général d’armée, lui succédait automatiquement.
Mais après 17 ans de règne, pendant lesquels il avait réussi à briguer au forceps deux mandats politiques de cinq ans, il était toujours incapable de mettre fin aux massacres des populations dans l’est du territoire. Ainsi fut-t-il contraint, par une sorte de compromis électoral avec les partis politiques, notamment avec l’Union pour la Démocratie et le progrès Social (UDS), de rendre le pouvoir aux civils après une élection qui portait au sommet de l’État Félix Tshisekedi. Malgré l’arrivée de ce dernier aux Affaires en 2018, les Congolais n’ont toujours pas fini de compter, en masse, leurs morts au Kivu.
Installation des groupes rebelles dans l’est du pays
Situé au cœur du continent, le Zaïre avait souvent été l’objet d’attaques extérieures par des groupes rebelles lumumbistes taxés de communistes. Ces groupes avaient trouvé refuge dans la frontière est du pays. Car ils avaient la possibilité de s’y ravitailler en armes et en munitions grâce au pillage des ressources minières, très prisées pour les grandes compagnies industrielles, qui regorgent dans cette zone. Mobutou réussissait toujours à les repousser avec l’aide des mercenaires venus de l’Occident.
Mais lâché par ses paires à la fin de la bipolarisation du monde, son armée s’était affaiblie en un temps record rendant ainsi les frontières du pays poreuses. C’était donc presque sans effusion de sang que le lumumbiste Laurent Désiré Kabila avait réussi à s’emparer du pouvoir. « La chute du maréchal Mobutu a lieu le 16 mai 1997. Ce jour-là, le Zaïre tourne la page du « Léopard ». Le lendemain, le 17, les troupes de l’AFDL entrent victorieuses dans Kinshasa, sans aucune résistance des Forces armées zaïroises. ».
Ainsi peut-on lire sur le site de Rfi dans un article paru en 2017 au sujet de l’ancien président zaïrois. Une fois à la tête de l’État, le nouvel homme fort rebaptisait le territoire République Démocratique du Congo, ancien nom du pays lors de son accession à l’indépendance en 1960.
Mais l’affection que lui vouaient les anciens zaïrois étaient retombée lorsque ses rebelles, faisant dorénavant partie de l’armée nationale, pour la plupart des non Congolais, avaient commencé des exactions de tout genre sur le peuple. C’est ainsi qu’il fut obligé de se séparer d’eux pour ne pas perdre la confiance et le soutien de ses concitoyens. Très mécontents de cette décision de leur ancien acolyte, les rebelles avaient replié dans l’est du pays, où ils allaient tenter plusieurs assauts afin de le renverser.
Notons que si les rebelles ont toujours choisi cette zone, outre ses richesses, c’est parce qu’elle est très difficile à contrôler, sans aides extérieures, par un État du tiers monde. On se souvient très bien que c’est à partir de cette même zone que Laurent Désiré Kabila, toujours porté par une coalition de groupes rebelles, dirigée par l’illustre Che Guevara, avait envahi, en 1967, les 3/4 du Zaïre avant d’être repoussé par Mobutou.
Des massacres à grande échelle
Première guerre du Congo
Depuis 1996, le Congo a connu trois grandes guerres. La première, encore appelée « guerre de libération », est celle qui emmène Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Elle se déroule de fin 1996 à mai 1997. Elle fut, on peut dire, pacifique car l’armée de l’ancien président, étant déjà défectueuse, les militaires avaient préféré de se rendre plutôt que de résister et se faire saigner inutilement.
Selon le journaliste François Soudan, le général Mahelé, alors chef d’état-major du Zaïre, aurait donné le plan des positions des militaires zaïrois aux rebelles lors de la bataille de Kenge, dernier bastion de la résistance avant d’entrer dans la capitale politique Kinshasa. Cet affrontement avait fait 250 morts entre militaires et rebelles. C’était d’ailleurs le deuxième affrontement entre les deux camps après la bataille de Lemara qui avait, des mois plutôt, causé 39 morts toujours entre militaires et rebelles.
Au total, les pertes en vies humaines, lors de la première guerre du Congo, peuvent être estimées à 289 morts. Mais selon certains rapports des missions de l’ONU au Congo, encore non officiel, plus de 200.000 réfugiés hutus auraient disparu lors des attaques des rebelles à l’est du pays. Ceci est d’ailleurs soutenu par les écrivains Marc Le Pape et Jean-Hervé Bradol dans leur livre « Les disparus du Congo-Zaïre 1996-1997 ». La question des massacres de réfugiés rwandais hutus en République démocratique du Congo. Charles Onana en parle aussi sans oublier l’article de l’écrivain belge David Van Reybrouck, « Congo, une histoire ».
Deuxième guerre du Congo
Le 02 août 1998, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), soutenu par le Rwanda et l’Ouganda, lançait les attaques à l’est du pays. Très rapidement, ce mouvement mettait la main sur les ressources minières et s’installait à Goma. Après avoir pris le contrôle des villes de Bukavu et Uvira, ces rebelles prenaient la direction de Kinshasa. Quelques semaines leur avaient suffi pour se retrouver aux portes de la cité capitale. Malgré le soutien des milices Maï-Maï et des forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), mouvement rebelle hutu, hostile aux gouvernements rwandais et burundais, Laurent Désiré Kabila ne parvint pas à contrer les rebelles du RCD. C’est ainsi qu’il fut obligé de lancer un appel de détresse international.
Les premiers à répondre furent les membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe en abrégé SADC en anglais. La Namibie, le Zimbabwe et l’Angola vinrent donc soutenir les armées de la RDC. Plus tard, ils furent rejoints par le Soudan, le Tchad et la Libye. Nous sommes donc de plain-pied dans la deuxième guerre du Congo encore appelée « la grande guerre africaine » ou la « première guerre mondiale africaine ». Après d’âpres affrontements sur plusieurs années, entre les alliés et les groupes rebelles qui en faisaient déjà une trentaine, particulièrement soutenus par le Rwanda et l’Ouganda, un cessez-le-feu fut signé sous la supervision de l’ONU le 31 décembre à Gbadolite.
Le 30 juin 2003, un gouvernement de transition, entérinant officiellement la fin de la deuxième guerre du Congo, est formé. Cette guerre, selon le rapport de l’International Rescue Committee, aurait causé plus de 4,5 millions de morts avec des millions de déplacés et de réfugiés.
La guerre du Kivu
Après la formation du gouvernement de transition en 2003, l’armée congolaise fut reformée et rebaptisée sous le nom de Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).
Plusieurs leaders des différents groupes rebelles y furent intégrés. Parmi eux, se trouvait Laurent Nkunda, le leader du Congrès nationale pour la défense du peuple (CNDP). Il intégrait la nouvelle armée comme colonel. Quelques mois plus tard, il devint général. En 2004, alors que les FARDC menaient des offensives contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ce dernier décida de démissionner de l’armée pour entrer au maquis. En mai 2004, il lançait les hostilités contre les FARDC avec pour prétexte de prévenir un génocide. C’est le début de la guerre du Kivu qui ne connaîtra jamais un terme. Ce sera plutôt un conflit entrecoupé d’intermèdes qui se déroule jusqu’à ce jour dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l’Ituri. Si Wikipédia parle de 11 873 morts, notons qu’aucune source n’a encore donné le chiffre exact des dommages humains causés par cette interminable guerre.
Des viols systématiques
Le viol est une autre arme de guerre que les groupes rebelles utilisent pendant leurs multiples attaques. Depuis plus de 20 ans que l’est de la République démocratique du Congo est en ébullition, la journaliste Anne Guion, dans son article « Guerre du Kivu : des chrétiens au chevet des femmes violées », publié le 27 novembre 2012 dans l’hebdomadaire La vie, parle de plus de 500.000 femmes violées. Outre les stigmatisations que sont victimes les enfants issus de ces viols, l’autre conséquence de cette barbarie réside dans les mutilations génitales que les rebelles pratiquent sur la plupart des femmes violées. Surnommé « l’homme qui répare les femmes », le gynécologue Denis Mukwege, qui vit au quotidien ces horreurs, a décidé depuis 2012 de les faire connaître à la communauté internationale. Cet engagement lui a d’ailleurs valu la distinction du prix Nobel de la paix en 2018.
Un génocide en prélude à la création de la République des volcans
Pour le journaliste et politologue Charles Onana, derrière ces massacres, ces viols et ces mutilations génitales, se cache un projet fortement mûri depuis des années. Spécialiste de la région des grands lacs, il explique, au micro d’André Bercoff sur Sud Radio, qu’il s’agit de la théorie du grand remplacement. Exterminer les populations de cette partie du Congo pour les remplacer par des Tutsis afin de créer un État dénommé la République des volcans est l’objectif que poursuivent les présidents Rwandais, Burundais et Ougandais car ce sont eux qui soutiennent les différents groupes rebelles qui y sèment la terreur. Une thèse de génocide soutenue par l’Organisation des Nations unies dans le Projet Mapping qui avait documenté les différents massacres qui s’étaient déroulés entre 1993 et 2003. Ceci avait alors suscité les colères des présidents mis en cause qui continuent de réfuter, avec la dernière goutte d’énergie, ce rapport.